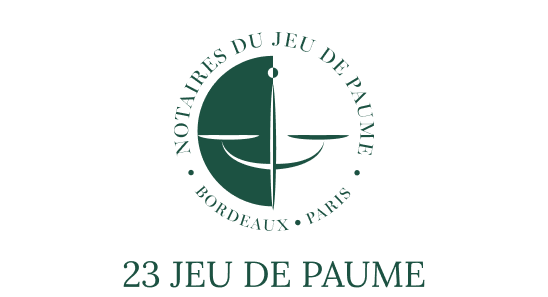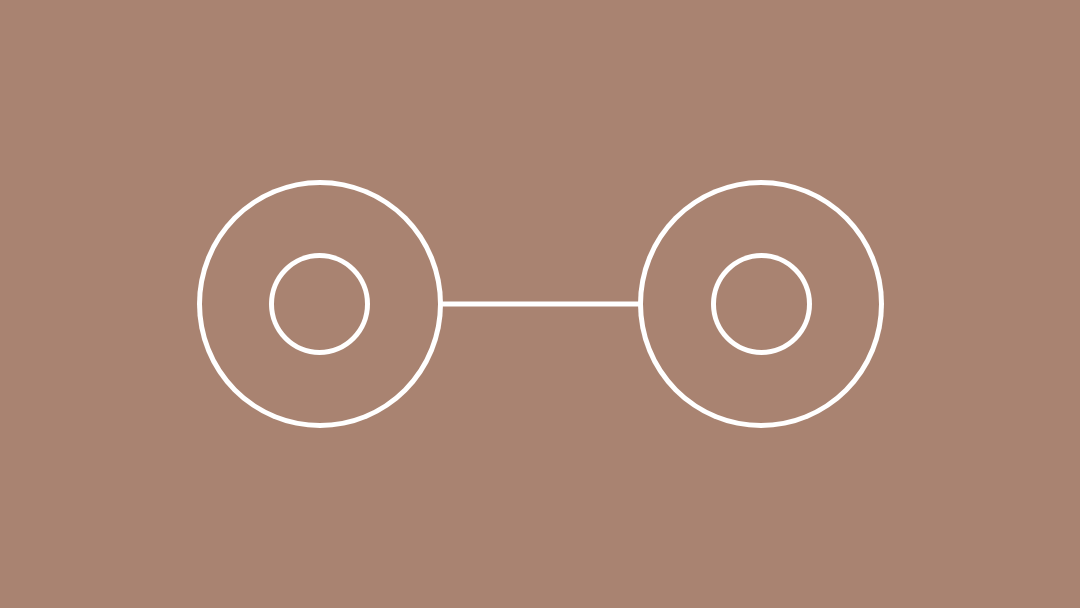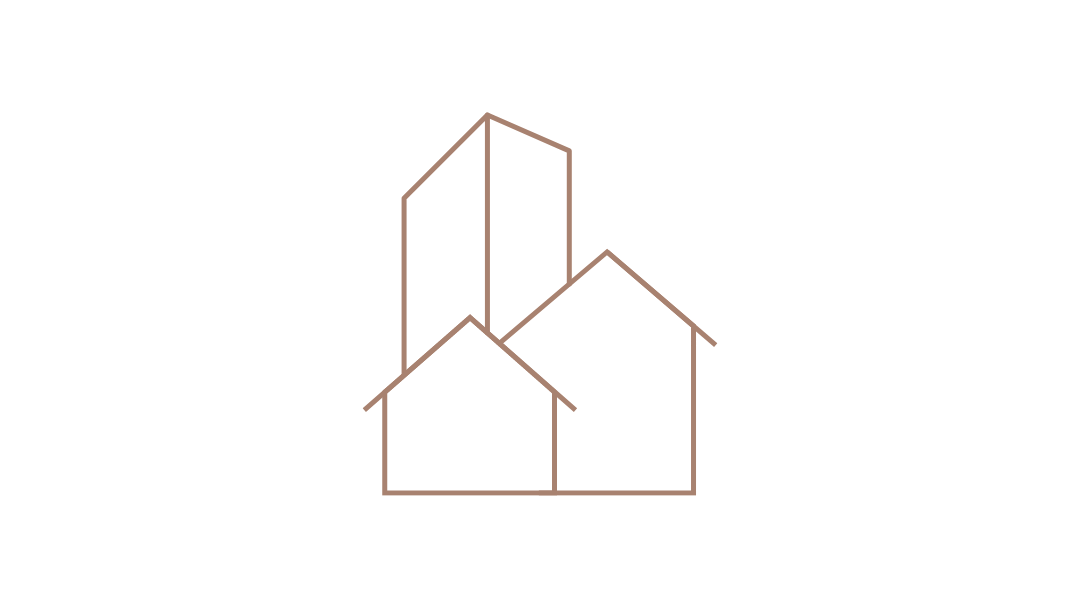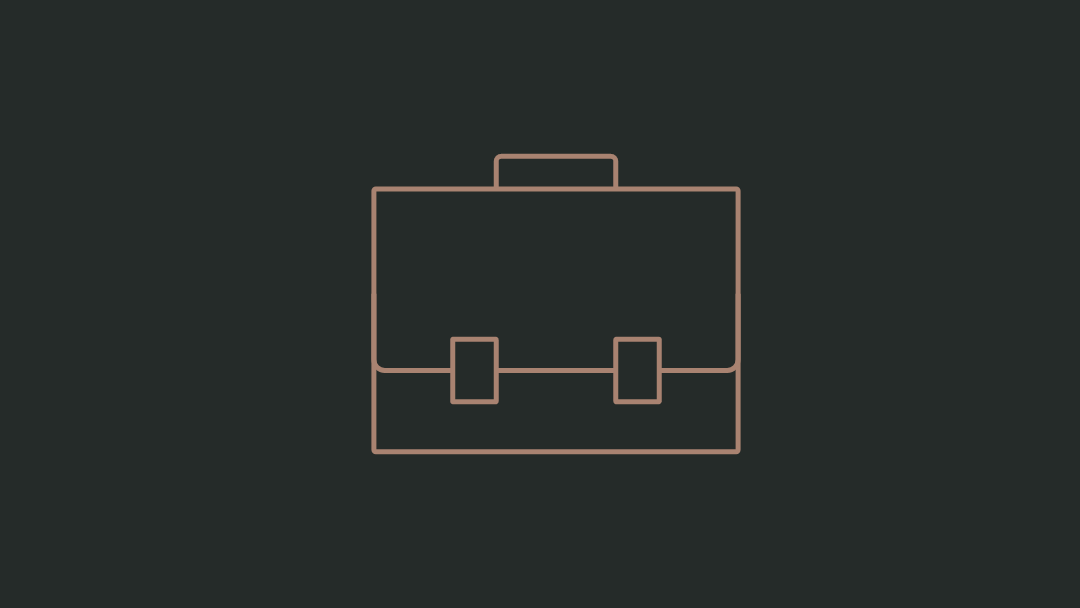Le fonds de commerce est un ensemble d’éléments utilisés pour exercer une activité commerciale
Il regroupe différents éléments incorporels (enseigne, nom commercial, éventuellement droit au bail…) et corporels (meubles, outils, stock…)
Les points de vigilances
- Informer : les salariés au moins deux mois avant la vente pour qu’ils puissent faire une offre de rachat, si l’entreprise compte moins de 250 salariés.
- Rédiger et signer : l’acte de cession du fonds de commerce pour ensuite aller enregistrer l’acte de vente auprès du service des impôts des entreprises et pour déterminer les droits d’enregistrement et les taxes dues.
- Publier : une annonce légale dans un journal habilité dans les 15 jours suivant la vente puis immatriculer l’entreprise sur le site du guichet unique des formalités des entreprises, quel que soit le type d’activité (commerciale, libérale…).
La déclaration au registre national des entreprises (RNE) et la demande d’immatriculation au registre des commerces.
A combien s’élèvent les honoraires de votre notaire ?
Pour ce service, les honoraires dépendront de la difficulté de la mission, et du temps consacré. Il faudra directement prendre rendez-vous avec votre notaire pour faire un point sur le dossier, et déterminer un prévisionnel de coût.