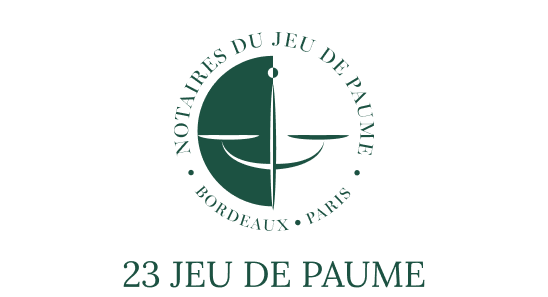Qui est propriétaire, dans quelles proportions ?
Le couple, en indivision, doit s’accorder sur les parts de propriété de chacun avant l’achat, car l’acquisition n’est pas forcément à moitié-moitié. Sans précision dans l’acte, les partenaires pacsés ou concubins détiennent le bien à parts égales.
Les frais d’entretien, d’amélioration et de réparation sont répartis selon les parts de propriété de chacun. Les décisions majeures, comme la vente, nécessitent l’accord des deux membres du couple. En cas de désaccord bloquant, les partenaires ou concubins peuvent saisir un juge pour résoudre le conflit.
Que se passe-t-il en cas de séparation ou de vente ?
En cas de séparation, l’un des partenaires ou concubins peut racheter la part de l’autre, mettant ainsi fin à l’indivision.
L’acquéreur doit être en mesure de financer l’achat total ( reprise du prêt restant et rachat de la part) pour que l’autre ne soit plus responsable du remboursement à la date de la séparation.
En cas de vente du bien immobilier, le prix est réparti selon les pourcentages de propriété indiqués dans l’acte d’achat. Si aucune répartition n’a été prévue, le prix est partagé à parts égales.
Si les partenaires ou concubins s’entendent pour reconnaître des créances entre eux, alors le notaire pourra établir un partage du prix de vente, en répartition différente de celle du titre de propriété.
Que se passe-t-il en cas de décès d’un des partenaires ?
1. LE DROIT À HÉRITER
Le partenaire ou concubin survivant n’hérite pas automatiquement ; un testament est nécessaire. Sans testament, il se retrouve en indivision avec les héritiers et devra racheter leurs parts pour garder le bien.
Se pose aussi la question de fiscalité : sans PACS, la fiscalité d’une transmission par testament sera celle existant au profit des tiers (60%).
2. LE DROIT D’OCCUPATION
Contrairement au concubin, le partenaire pacsé survivant bénéficie d’un droit d’usage gratuit d’un an sur le logement principal et son mobilier, à condition que le bien appartienne au défunt ou aux deux partenaires. Après un an, il doit en principe quitter le logement.