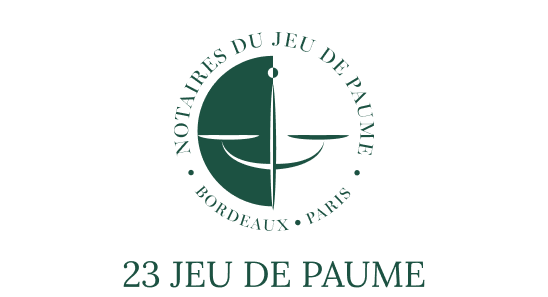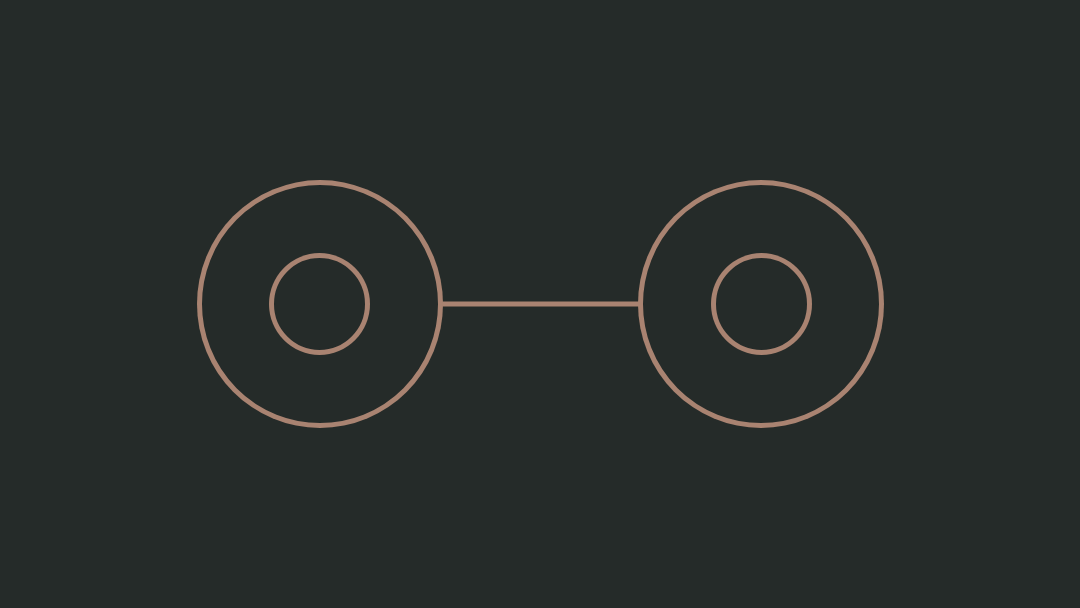Qu’est-ce qu’une donation ?
La donation se caractérise par la transmission de son vivant de la propriété ou du bien que l’on possède.
Outil de gestion patrimoniale important, elle est souvent utilisée pour planifier la succession et pour aider financièrement les membres de la famille ou des organisations caritatives de son vivant.
Qu’est-ce qui la caractérise ?
- Le transfert de propriété : bien immobilier, somme d’argent, parts de sociétés, entreprise, exploitation agricole…
- L’intention libérale : le souhait pour le donateur de transférer en tout ou partie un bien, avec ou sans charge.
- Le consentement mutuel : la donation n’est effective que s’il existe une volonté claire tant de celui qui donne que de celui qui reçoit, libre et éclairée.
- L’irrévocabilité de l’acte : La donation est définitive, sauf exceptions (article 955, révocation pour ingratitude).
- Les formalités légales : un acte notarié est conseillé pour les dons manuels, et nécessaire pour les autres cas.
- Capacité juridique : la donation peut être faite au profit d’un mineur, d’un majeur, ou d’un majeur protégé (analyse de situation à faire avec votre notaire).
Répartition anticipée de l’héritage entre les héritiers
La donation-partage permet de transmettre et répartir ses biens entre ses héritiers présomptifs, leur donnant immédiatement la propriété définitive, avec toutefois la possibilité de continuer à profiter des biens.
*Héritier qui, du vivant d’une personne, a vocation à lui succéder. Si cette personne venait à décéder, elle reccueillerait tout ou une partie des biens de son patrimoine.
Pourquoi faire une donation-partage ?
- Prévenir les conflits : Répartir ses biens de son vivant prévient les litiges entre héritiers.
- Assurer l’équité : Tenir compte des donations antérieures pour traiter équitablement les héritiers si c’est là votre intention..
- Optimisation fiscale : Utiliser les abattements pour les donations et geler la valeur des biens pour éviter l’impact de leur future valorisation.
- Gestion de l’entreprise familiale : transmettre l’entreprise de manière structurée en assurant une continuité (optimisation fiscale possible avec Pacte Dutreil)